- Texte
- Histoire
Une redéfinition du roman Avec Mada
Une redéfinition du roman
Avec Madame Bovary, Flaubert, stakhanoviste du style, vivant l’écriture comme un culte, casse la structure du roman traditionnel.
Emma Bovary, lectrice passionnée de bluettes sentimentales, est victime de ses illusions et des aspirations qui excèdent sa condition de petite bourgeoise de province. Si le roman est une satire du romantisme féminin, il dénonce également un travers de la condition humaine. En poursuivant des rêves de bonheur tout aussi illusoires qu’inaccessibles, Emma incarne un type psychologique universel auquel elle donnera son nom, le bovarysme. D’autre part, il faut au romancier être objectif à tout prix, s’il veut faire valoir la vérité de ses écrits. Ses sentiments personnels ne doivent pas se montrer, comme s’il était absent de son œuvre. Ainsi, le roman ne saurait obéir à une thèse moralisatrice, même si tout art est moral et toute œuvre vraie porte en elle un enseignement qui dépasse les intentions de l’auteur. Il s’en explique à George Sand le 6 février 1876 : « Si le lecteur ne tire pas d’un livre la morale qui doit s’y trouver, c’est que le lecteur est un imbécile ou que le livre est faux au point de vue de l’exactitude. » Le mot de « morale » doit être entendu ici selon l’acception de « leçon », souvent bien éloignée des diktats d’une époque conservatrice.
Pour Flaubert, l’artiste n’a pas d’autre mission que le Beau : « Le but de l’art, c’est le beau avant tout. » Il résulte d’un accord parfait entre le sens et la forme choisie pour l’exprimer. L’esthétisme a préoccupé Flaubert toute sa vie, rejoignant en cela certains de ses contemporains, comme Théophile Gautier et Charles Baudelaire : « C’est pour cela qu’il n’y a ni beaux ni vilains sujets, explique-t-il à Louise Colet le 16 janvier 1852, et qu’on pourrait presque établir comme axiome, en se plaçant au point de vue de l’art pur, qu’il n’y en a aucun, le style étant à lui seul une manière absolue de voir les choses. » Travailleur infatigable de la phrase, Flaubert pouvait reprendre des dizaines de fois l’écriture d’un même paragraphe, passant une matinée à mettre une virgule, et une après-midi à l’ôter, avant de le soumettre à l’épreuve du « gueuloir » où il en faisait la lecture.
Avec Madame Bovary, Flaubert, stakhanoviste du style, vivant l’écriture comme un culte, casse la structure du roman traditionnel.
Emma Bovary, lectrice passionnée de bluettes sentimentales, est victime de ses illusions et des aspirations qui excèdent sa condition de petite bourgeoise de province. Si le roman est une satire du romantisme féminin, il dénonce également un travers de la condition humaine. En poursuivant des rêves de bonheur tout aussi illusoires qu’inaccessibles, Emma incarne un type psychologique universel auquel elle donnera son nom, le bovarysme. D’autre part, il faut au romancier être objectif à tout prix, s’il veut faire valoir la vérité de ses écrits. Ses sentiments personnels ne doivent pas se montrer, comme s’il était absent de son œuvre. Ainsi, le roman ne saurait obéir à une thèse moralisatrice, même si tout art est moral et toute œuvre vraie porte en elle un enseignement qui dépasse les intentions de l’auteur. Il s’en explique à George Sand le 6 février 1876 : « Si le lecteur ne tire pas d’un livre la morale qui doit s’y trouver, c’est que le lecteur est un imbécile ou que le livre est faux au point de vue de l’exactitude. » Le mot de « morale » doit être entendu ici selon l’acception de « leçon », souvent bien éloignée des diktats d’une époque conservatrice.
Pour Flaubert, l’artiste n’a pas d’autre mission que le Beau : « Le but de l’art, c’est le beau avant tout. » Il résulte d’un accord parfait entre le sens et la forme choisie pour l’exprimer. L’esthétisme a préoccupé Flaubert toute sa vie, rejoignant en cela certains de ses contemporains, comme Théophile Gautier et Charles Baudelaire : « C’est pour cela qu’il n’y a ni beaux ni vilains sujets, explique-t-il à Louise Colet le 16 janvier 1852, et qu’on pourrait presque établir comme axiome, en se plaçant au point de vue de l’art pur, qu’il n’y en a aucun, le style étant à lui seul une manière absolue de voir les choses. » Travailleur infatigable de la phrase, Flaubert pouvait reprendre des dizaines de fois l’écriture d’un même paragraphe, passant une matinée à mettre une virgule, et une après-midi à l’ôter, avant de le soumettre à l’épreuve du « gueuloir » où il en faisait la lecture.
0/5000
Redefinition ของนวนิยาย มาดาม Bovary, Flaubert สไตล์ อาศัยพระคัมภีร์เป็นคำว่าลัทธิ Stakhanovite แบ่งโครงสร้างนวนิยายดั้งเดิม เอ็มม่า Bovary ชอบอ่านอันอ่อนหวาน asinine เหยื่อของภาพลวงตาของเขาและความปรารถนาที่เกินสภาพของชนชั้นกลางขนาดเล็ก โดยจังหวัดได้ ถ้านิยายเป็นการเสียดสีของศิลปะจินตนิยมผู้หญิง เขาประณามเทรเวอร์สเงื่อนไขมนุษย์ ใฝ่หาความฝันความสุข illusory ยังว่า ไม่ เอ็มม่าก็ชนิดจิตสากลซึ่งมันจะให้ชื่อของเขา bovarysme บนมืออื่น ๆ ที่คนเขียนต้องมีวัตถุประสงค์ที่ทั้งหมดค่าใช้จ่าย ถ้าอยากยืนยันรูปจริงของงานเขียนของเขา ความรู้สึกส่วนตัวของเขาควรไม่แสดงตัว ว่าเขาขาดจากการทำงานของเขา ดังนั้น นวนิยายไม่ฟังวิทยานิพนธ์ moralistic แม้ว่าศิลปะทั้งหมดที่มีคุณธรรม และดำเนินการทำงานจริงกับการศึกษาที่เกินกว่าความตั้งใจของผู้เขียน เขาอธิบายกับจอร์จทราย 6 1876 กุมภาพันธ์: "ถ้าเล่นไม่ได้มารยาทที่ต้องวาดหนังสือ ที่อ่านเป็นคนบ้า หรือว่าหนังสือผิดจากมุมมองของความถูกต้อง" ควรเข้าใจคำว่า "ศีลธรรม" ของที่นี่ตามความหมายของ 'บทเรียน' มักไกลออกจากบอกของยุคหัวเก่า สำหรับ Flaubert ศิลปินมีภารกิจอื่น ๆ ไม่มากกว่าความสวยงาม: "วัตถุประสงค์ของศิลปะ มันเป็นความสวยงามอันดับแรก" มันเป็นผลของ triad ระหว่างความหมายและรูปแบบที่เลือกที่จะแสดงมัน สุนทรียศาสตร์เกี่ยวข้อง Flaubert ตลอดชีวิตของเขา เข้าร่วมในที่ของเขา contemporaries, Théophile Gautier และชาร์ลส์บอเดแลร์: "ได้อธิบายเหตุผลนี้ว่า มีเรื่องที่ไม่สวยงาม หรือน่าเกลียด การ Colet หลุยส์ 16 มกราคม 1852 และที่เกือบจะเป็นสัจพจน์ ณขณะที่มุมมองของศิลปะบริสุทธิ์ ที่มีไม่มี ลักษณะมีเขาเฉพาะวิธีแน่นอนของการมองเห็น "ผู้ปฏิบัติงาน tireless ของประโยค Flaubert สามารถต่อหลายสิบครั้งเขียน ตั้งแต่เช้าเครื่องหมายจุลภาค และในช่วงบ่ายจะเอาออก ก่อนที่จะส่งไปทดสอบ 'gueuloir' ที่เขาได้อ่านย่อหน้าเดียวกัน
En cours de traduction, veuillez patienter...
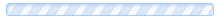
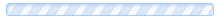
redefinition ของนวนิยายเรื่องนี้กับมาดามBovary, ฟลอว์ที่อยู่อาศัยสไตล์ Stakhanovite เขียนเป็นลัทธิทำลายโครงสร้างของนวนิยายแบบดั้งเดิม. เอ็มม่า Bovary อ่านตัวยงของมโนสาเร่ซาบซึ้งเป็นเหยื่อของภาพลวงตาและแรงบันดาลใจของเขาที่เกินสภาพของเขา จังหวัดชนชั้นกลางขนาดเล็ก หากนวนิยายเรื่องนี้เป็นถ้อยคำของความโรแมนติกหญิงก็ยังประณามผ่านเงื่อนไขของมนุษย์ ใฝ่หาฝันของความสุข qu'inaccessibles จริงอย่างเท่าเทียมกัน, เอ็มม่าคาดเดาประเภทสากลทางด้านจิตใจเพื่อที่จะทำให้ชื่อของ bovarysm ในทางกลับกันนักประพันธ์จะต้องมีวัตถุประสงค์ที่ค่าใช้จ่ายทั้งหมดถ้าเขาต้องการที่จะยืนยันความจริงของงานเขียนของเขา ความรู้สึกส่วนตัวของเขาไม่ควรจะแสดงขึ้นเช่นถ้าเขาได้รับการขาดจากการทำงานของเขา ดังนั้นนวนิยายไม่เชื่อฟังอาร์กิวเมนต์ที่เชื่อมั่นในศีลธรรมแม้ว่าศิลปะคือศีลธรรมและการทำงานจริงทุกดำเนินการเรียนการสอนที่นอกเหนือไปจากความตั้งใจของผู้เขียน เขาอธิบายว่าจอร์จแซนด์ 6 กุมภาพันธ์ 1876: "ถ้าผู้เล่นไม่ได้วาดเป็นหนังสือที่มีคุณธรรมที่ควรจะมีผู้อ่านเป็นปัญญาอ่อนหรือหนังสือที่ไม่ถูกต้องไปยังจุดที่ แง่ของความถูกต้อง "คำว่า" ศีลธรรม "ต้องเข้าใจนี่เป็นความหมายของ" บทเรียน "ที่มักจะอยู่ห่างไกลจากคำสั่งของยุคพรรค. สำหรับฟลอว์ศิลปินไม่มีภารกิจอื่น ๆ นอกเหนือจากที่สวยงาม" วัตถุประสงค์ของงานศิลปะที่มีความสวยงามเหนือสิ่งอื่นใด "มันเป็นผลมาจากข้อตกลงที่สมบูรณ์แบบระหว่างความหมายและรูปแบบที่เลือกที่จะแสดงมัน สุนทรียศาสตร์ได้หมกมุ่นอยู่กับฟลอว์ตลอดชีวิตของเขาเข้าร่วมในบางส่วนของโคตรของเขาเช่นThéophileโกติเยร์และชาร์ลส์โบดแลร์: "สำหรับเรื่องนี้มีทั้งเรื่องที่สวยงามหรือน่าเกลียดเขาอธิบาย หลุยส์ Colet 16 มกราคม 1852 และคุณสามารถตั้งค่าเกือบจะเป็นความจริงโดยการวางมุมมองของศิลปะบริสุทธิ์ที่ไม่มีใครสไตล์อยู่ในตัวเองเป็นวิธีที่แน่นอน สิ่งที่เห็น "คนงานที่ไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยของประโยค, ฟลอว์อาจจะใช้เวลาหลายสิบครั้งการเขียนย่อหน้าตั้งแต่เช้าที่จะนำเครื่องหมายจุลภาคและช่วงบ่ายจะลบทดสอบก่อนที่จะส่งของ "gueuloir" ที่เขากำลังเล่น
En cours de traduction, veuillez patienter...
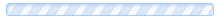
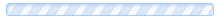
ความหมายของนวนิยายกับมาดามโบวารี
โฟลแบร์ , Russia สไตล์ชีวิตของผู้เขียนในฐานะที่เป็นศาสนาแบบดั้งเดิมที่จะทำลายโครงสร้างของนวนิยาย . . . . . . .
bluettes เอ็มม่า bovary ผู้อ่านอารมณ์ความรู้สึกจินตนาการและความปรารถนาที่จะได้รับในส่วนของจังหวัดสภาพชนชั้นกลาง ถ้าเป็นคำประชดของนวนิยายโรแมนติกของผู้หญิงนอกจากนี้เขายังกล่าวหาว่าทั้งสภาพความเป็นอยู่ของมนุษย์ ไล่ตามความฝันความสุขที่เป็นภาพลวงตาที่จะสะท้อนให้เห็นถึงจิตที่เป็นสากลและเอ็มม่าจะ bovary ตัวละครชื่อของเธอ บนมืออื่นๆ , เราต้องทำทุกอย่างที่จะเป็นนักเขียนที่เป็นเป้าหมายและถ้าเขาต้องการที่จะรักษาความจริงของงาน ความรู้สึกส่วนตัวของเธอไม่ได้ดู
โฟลแบร์ , Russia สไตล์ชีวิตของผู้เขียนในฐานะที่เป็นศาสนาแบบดั้งเดิมที่จะทำลายโครงสร้างของนวนิยาย . . . . . . .
bluettes เอ็มม่า bovary ผู้อ่านอารมณ์ความรู้สึกจินตนาการและความปรารถนาที่จะได้รับในส่วนของจังหวัดสภาพชนชั้นกลาง ถ้าเป็นคำประชดของนวนิยายโรแมนติกของผู้หญิงนอกจากนี้เขายังกล่าวหาว่าทั้งสภาพความเป็นอยู่ของมนุษย์ ไล่ตามความฝันความสุขที่เป็นภาพลวงตาที่จะสะท้อนให้เห็นถึงจิตที่เป็นสากลและเอ็มม่าจะ bovary ตัวละครชื่อของเธอ บนมืออื่นๆ , เราต้องทำทุกอย่างที่จะเป็นนักเขียนที่เป็นเป้าหมายและถ้าเขาต้องการที่จะรักษาความจริงของงาน ความรู้สึกส่วนตัวของเธอไม่ได้ดู
En cours de traduction, veuillez patienter...
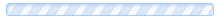
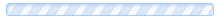
Autres langues
l'outil d'aide à la traduction: Afrikaans, Albanais, Allemand, Amharique, Anglais, Arabe, Arménien, Azéri, Basque, Bengali, Birman, Biélorusse, Bosniaque, Bulgare, Catalan, Cebuano, Chichewa, Chinois, Chinois traditionnel, Cingalais, Corse, Coréen, Croate, Créole haïtien, Danois, Détecter la langue, Espagnol, Espéranto, Estonien, Finnois, Français, Frison, Galicien, Gallois, Gaélique (Écosse), Grec, Gujarati, Géorgien, Haoussa, Hawaïen, Hindi, Hmong, Hongrois, Hébreu, Igbo, Irlandais, Islandais, Italien, Japonais, Javanais, Kannada, Kazakh, Khmer, Kinyarwanda, Kirghiz, Klingon, Kurde, Laotien, Latin, Letton, Lituanien, Luxembourgeois, Macédonien, Malaisien, Malayalam, Malgache, Maltais, Maori, Marathi, Mongol, Norvégien, Néerlandais, Népalais, Odia (oriya), Ouzbek, Ouïgour, Pachtô, Panjabi, Persan, Philippin, Polonais, Portugais, Roumain, Russe, Samoan, Serbe, Sesotho, Shona, Sindhî, Slovaque, Slovène, Somali, Soundanais, Suédois, Swahili, Tadjik, Tamoul, Tatar, Tchèque, Telugu, Thaï, Turc, Turkmène, Ukrainien, Urdu, Vietnamien, Xhosa, Yiddish, Yorouba, Zoulou, indonésien, Traduction en langue.
- les braves
- la ligne
- Pussy
- horam
- les corageux
- le
- Anno dni 1761
- le style
- natum
- le style
- hodie
- le style
- couj
- root terhubung program cloud yang croot
- coûj
- root terhubung program cloud yang croot
- designing a booklet intended for teenage
- le style
- hello
- le style
- i'm learning korean
- le style
- Filio laudato, dominus seruos in agro mi
- horand

